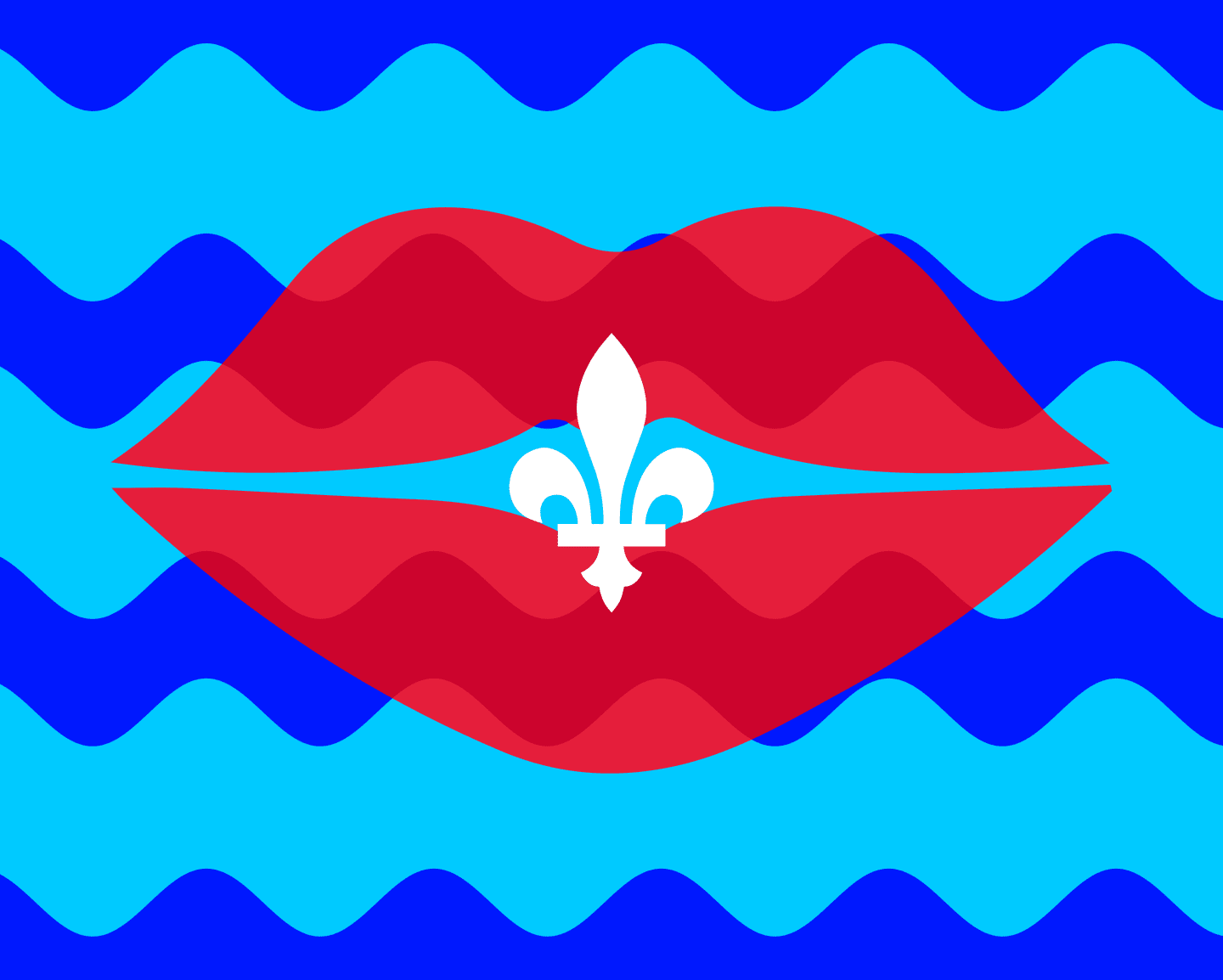 Maya Dufeu
Maya Dufeu
Montréal, au Québec, est l’endroit où des musiciens de pop progressive tels que Grimes, Arcade Fire et Kaytranada ont fait leurs débuts, mais ces artistes ont réussi sur la scène internationale en tant qu’étrangers. Le Québec est la deuxième province la plus peuplée du Canada et son industrie musicale est en grande partie indépendante du reste du pays. Elle a un star système autosuffisant, alimenté par une culture radiophonique bien ancrée et des labels indépendants comme Dare to Care, Audiogram, Coyote Records, Indica Records et plusieurs autres. Au Québec, les artistes et les maisons de disques de langue française jouissent de privilèges uniques en raison des lois protégeant la culture francophone de la province et qui leur permettent de prospérer.
Le seul objectif de la Charte de la langue française de 1977 était de « faire du français la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires ». Les francophones blancs et catholiques, en particulier les baby-boomers s’identifiant comme « Québécois » – un qualificatif qui peut évoquer un certain sentiment nationaliste –, en sont venus à dominer la culture par défaut de la province, des institutions gouvernementales jusqu’aux arts. Ce nationalisme tacite, établi par le biais de la protection de la langue, exclut toutefois la présence des peuples autochtones sur cette terre. Et, puisque la Charte a été mise en place pour assimiler les nouveaux arrivants, elle perdure maintenant depuis plusieurs vagues successives d’immigrants francophones et non francophones au Québec, en provenance d’ailleurs au pays et du monde entier.
Montréal, la plus grande ville et l’épicentre culturel du Québec, est plutôt diverse : selon les données du recensement de 2011, 56 % de la population se compose d’immigrants, et 57,7 % des gens sont bilingues. (Une étude datant de 2006 révélait même que 24 % des Montréalais sont trilingues.) Mais les mesures législatives protectrices ont eu un effet durable sur les questions de la diversité et de la représentation dans les médias québécois, de même que sur sa lucrative industrie musicale.
Finalement, à qui donne-t-on une chance? Aux artistes qui produisent de la musique principalement en français, et en accord avec ces idéaux culturels. À l’heure actuelle, un projet musical doit contenir 70 % de contenu en français afin d’être admissible à la majorité des programmes de subventions institutionnelles. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), un organisme indépendant qui règlemente la diffusion de contenu à l’échelle du pays, a créé des règles spéciales pour les stations de langue française: elles doivent consacrer 65 % de leur programmation hebdomadaire à la musique de langue française, et 35 % au contenu canadien. L’industrie québécoise fait la promotion de la musique en français car celle-ci est légalement reconnue comme culture dominante, bien que de nombreux artistes habitant à Montréal s’expriment et se produisent sur scène en anglais, en anglais/français et en « franglais ». Ces artistes ne se sentent pas représentés par la presse écrite et audiovisuelle, ni reconnus par les organismes qui récompensent les artisans comme l’ADISQ, soit l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo.
FADER s’est entretenu avec neuf acteurs de la scène musicale montréalaise afin de prendre le pouls de la création artistique bilingue ou multiculturelle dans une province francophone.
Frannie Holder, Random Recipe
Quand je choisis une langue avec laquelle j’écris, c’est pour une raison. C’est la choisir [comme] un synth pour sa texture et son son. J’ai chanté à la St-Jean. C’était une chanson avec Pierre Lapointe, et Fab et moi, on chante en anglais sur cet extrait-là. Mais ils nous ont demandé de changer [les paroles] et de les mettre en français. J’ai accepté de faire mon refrain en français, car c’est la fête du Québec et on célèbre un Québec francophone, fine. Mais Fab n’était pas à l’aise, et elle leur a demandé si elle pouvait le faire en espagnol. Les organisateurs ont dit : "n’importe quelle langue, c’est pas grave, sauf l’anglais." Je comprends, mais c’est weird !
Les gérants et les maisons de disques ne vont pas pousser des projets s’ils ne peuvent pas obtenir de financement. Il y a de bons liens entre la France et le Québec, mais ça ne m’intéresse pas de faire des tournées juste dans ces deux endroits-là. Si on veut tourner en Afrique du Sud, il n’y a aucun label qui va s’y intéresser, mais dès qu’ils ouvrent une branche pour financer des tournées dans là-bas, tout le monde se réveille ! Nous autres, on l’a fait parallèlement, en dehors des institutions.
Karim Ouellet, auteur-compositeur-interprète
Un artiste qui est né au Québec ou même ailleurs et qui se dit ‘‘québécois’’ fait de la musique québécoise. Les chansons que je veux écrire, je ne sais pas comment je les écrirais en anglais, comment je retrouverais cette poésie dans une autre langue. Mais je n’ai pas besoin de me battre comme mes amis qui font des albums bilingues ou 100% anglais, et qui ne sont pas reconnus dans les packages de subventions, les galas, etc. Milk & Bone en est un bon exemple. Pour moi, c’est de la musique québécoise même si c’est pas en français.
Laurence Lafond-Beaulne, Milk & Bone
Cette question-là, on se la fait seulement poser par des gens over 40 et que par des Québécois. Jamais un journaliste aux States ou en Europe va nous demander pourquoi on écrit nos chansons en anglais. C’est vraiment une question de baby-boomers ! On a été chanceuses d’avoir une certaine couverture médiatique du fait qu’on a commencé nos carrières en accompagnant beaucoup d’artistes francophones qui ont une belle visibilité. On chante en anglais mais on ne fait pas partie de la scène anglo non plus. C’est weird, mais c’est vraiment ça.
Seb Cowan, fondateur, Arbutus Records
Plusieurs labels [francophones] sont créés dans le but d’obtenir des subventions, parce que c’est un bon moyen d’aller chercher de l’argent. Nous avons récemment fini par comprendre comment s’y prendre et nous sommes toujours loin d’être les meilleurs, mais cela nous a permis de mettre sur pied un modèle plus durable, ou plus pertinent, musicalement parlant. Je me sens toujours comme si je n’étais pas chez moi. Je suis un anglophone et je ne parle pas la langue. J’ai toujours été très sensible à ce sujet.
Gourmet Délice, fondateur, Bonsound Records
Un de nos bands, Groenland, a joué au festival Quartiers d’hiver du FME en janvier 2015. Pierre Karl Péladeau [l’ancien chef de l’opposition officielle et du Parti québécois] était dans la salle et il a crié ‘‘en français, SVP !’’ pendant leur performance. Ça a fait un mini-scandale, mais pas autant que celui de Safia Nolin et de son T-shirt à l’ADISQ ! Ça a ramené leur album The Chase dans le top 200 sur iTunes au Canada; ça a fait du bruit. Ce qui est drôle, c’est que Péladeau était au show de Groenland, un groupe qui chante en anglais, et qui parle au public en français entre les chansons, parce qu’ils sont aussi francophones.
Étienne Dubuc, directeur de la programmation CISM RADIO 89.3 FM
Le quota de 65% de contenu francophone est légitime et réaliste. À CISM, même si le quota était plus bas, on essayerait quand même d’aller chercher plus de contenu en français que ce que font les radios commerciales. Il se fait assez de bonne musique en français pour avoir au moins un équilibre 50/50 dans le contenu qu’on diffuse en ondes. Si on ne met pas de l’avant cette musique-là, on perd un peu de notre identité et c’est ce qui nous différencie du reste du Canada et des États-Unis.
Ogden, Alaclair Ensemble
On s’adresse à notre public en français, avec un brin d’anglais. Je ne dirais pas qu’Alaclair fait du franglais. C’est un mélange de français, d’anglais et de créole haïtien. Dans notre cas, ça n’a jamais été un problème au niveau de la langue. On est toujours bien over les quotas de 70% de contenu francophone. C’est plus au niveau du genre. L’ADISQ ne boycotte pas le rap, mais c’est toujours une sous-catégorie. Les radios commerciales boycottent littéralement le rap québécois. Il existe une forme de racisme institutionnalisé : parfois inconscient, parfois plus ou moins conscient.
Je me demande : si Kaytranada était blanc, aurait-il une couverture médiatique adéquate au Québec? Ma réponse personnelle, c’est que ça changerait vraiment comment les médias francophones le couvrent.
C’est d’ailleurs pourquoi mon personnage, c’est Robert Nelson [un Anglo-Québécois, figure de proue du Bas-Canada et de la Rébellion des Patriotes de 1837-1838]. Il voulait créer une société beaucoup plus à l’américaine, une république dans laquelle le français et l’anglais auraient été des langues officielles. J’ajouterais aussi les langues autochtones, car c’était les premiers à proposer que les Amérindiens aient les mêmes droits que les Blancs. Le Québec francophone risque de se raffermir dans une identité conservatrice et de droite sur la notion de l’identité francophone.
Il y a un héritage francophone moderne de survie et un désir de protection qui génèrent cette impression que tout ce qui a lieu en anglais ne concerne pas les Québécois. C’est pour ça que Kaytra est mis de côté alors qu’il est l’artiste québécois le plus gros au monde en ce moment. Peut-être à part Céline Dion et Arcade Fire.
Matthew Otto, ex-Majical Cloudz
J’ai l’impression qu’on lutte pour trouver un sentiment d’unité dans la ville en ce qui concerne les arts. Il existe clairement un clivage anglo-franco. Ce n’est pas comme si je ne faisais pas d’efforts. Seulement que je n’ai jamais très bien compris comment les rejoindre.
High Klassified, producteur
Quand je parle avec mes fans sur Internet, je le fais en anglais, puisque ça me permet de rejoindre plus de gens. Par contre, quand je travaille avec des gens de mon pays, je m’adresse en français. Pour être honnête, j’aime pas vraiment parler anglais vu que j’suis bègue. J’ai plus de difficulté à m’exprimer en anglais qu’en français.
Le terme ‘‘musique québécoise’’ est une question de langue et de territoire. I mean, ça dépend de l’identité de l’artiste. On n’a pas des artistes anglophones qui se promènent avec des drapeaux du Québec and shit. Les rappeurs anglais d’ici vont plus s’identifier comme Canadiens. Je considère vraiment que les rappeurs franglais sont des rappeurs québécois, parce que c’est ça, l’identité du Québec. C’est notre langue.
Traduit par Michael-Oliver Harding